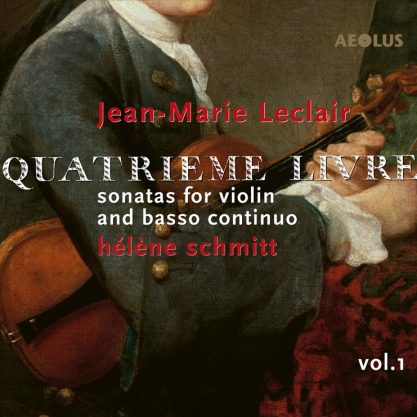Entretien avec Hélène Schmitt, violoniste baroque

© Guy Vivien
[clear]
“Finalement nous, les musiciens, sommes des passeurs ; les violons restent, et nous passons.”
L’entretien n’était pas vraiment prévu… ou presque. Et voici que par la magie festivalière, ce concentré d’humanité musicale en un lieu si restreint, nous voici avec Hélène Schmitt pour rester ensemble dans les cordes. Bien entendu.
Muse Baroque : Parlez-nous tout d’abord de votre formation… Comment en êtes-vous venue à faire spécifiquement du violon baroque ? Quelle a été la vision que portaient là-dessus vos collègues ?
Hélène Schmitt : J’ai commencé à l’époque où ça n’était pas bien vu, c’était loin d’être en odeur de mode. J’ai étudié à l’étranger, il n’y avait d’ailleurs guère le choix : il y avait les Pays-Bas ou la Suisse. J’ai rencontré Chiara Banchini… Ce n’est pas elle qui a déclenché mon amour pour la musique baroque, même si elle l’a ô combien ouvert et fortifié : il était là en réalité depuis toujours ! Déjà, dans mon apprentissage de violoniste, tous mes professeurs de violon moderne me disaient, lorsque j’avais le libre choix d’une pièce à étudier “Oh, encore Bach, encore Mozart ! Joue d’autres choses !” Chaque fois qu’on me donnait le choix, je me tournais vers la musique baroque, pas forcément sciemment. C’était en moi, même si je ne le savais pas. Je pense qu’il y avait déjà des graines, des germes de fleurs, dans mon naturel, qui me prédisposaient bien à l’amour de cette musique : j’avais un caractère qui pouvait se reconnaître et s’épanouir dans cette musique pleine d’affects violents et brusques, de volte-faces, de rires et de larmes, contenus les uns dans les autres, aussi vite chantournés qu’évanouis. Je pense que ça correspondait bien au caractère de la jeune fille que j’étais, et puis de la femme que je suis devenue.
À ce moment-là, la musique classique et son apprentissage se cherchaient dans une atmosphère s’ouvrant à de nouveaux idéaux. La musique était encore extrêmement corsetée dans son enseignement — elle l’est toujours — sans doute parce qu’il n’y a pas mille façons de l’apprendre ! En même elle visait des échappatoires à son conformisme un peu ronronnant. Et c’est sans doute pour cela que la musique baroque et ses ardents défenseurs venus principalement des provinces germaniques et du Nord ont pu peu à peu souffler de nouvelles graines de ferveur dans les grandes écoles de musique où l’on cherchait de nouveaux horizons, tout en s’en défendant.
Les maîtres transmettent à leurs élèves un peu comme les parents à leurs enfants, c’est-à-dire des valeurs qui ont fait leurs preuves et qui sont anciennes. À la jeunesse de les prendre, d’en faire son miel et de les bousculer ! Pour tout, pas plus pour le violon baroque qu’autre chose.
Vers mes vingt-deux ans, je m’interrogeais sur ce que j’allais faire avec le violon. J’avais fini mes études au conservatoire, j’avais obtenu un premier poste à l’orchestre de Montpellier où j’avais joué beaucoup d’opéra — pour mon plus grand bonheur d’ailleurs — et je comprenais, cahin-caha, que cette voie-là n’était peut-être pas celle qui allait me rendre la plus heureuse, qui allait correspondre à la femme et à la musicienne que j’étais en train de devenir.
J’avais un ou deux amis qui étudiaient la musique ancienne, comme le luthiste Pascal Monteilhet par exemple, qui finissait ses études à Bâle. J’ai décidé de quitter l’orchestre de Montpellier, je suis revenue à Paris où j’avais fait mes études, j’ai travaillé à l’orchestre de Radio France, et j’y ai eu la même impression que quelque chose ne me rendait pas heureuse là, malgré la grande chance que j’avais de jouer avec un magnifique orchestre, reconnu et apprécié. J’avais profondément envie d’être une musicienne et en même temps rien ne correspondait là à la fougue de la jeune fille, toujours palpitant en moi et que j’avais et j’ai toujours envie d’offrir à la musique; je voulais pouvoir défendre ce que je faisais et l’arroser patiemment. Dès que j’ai vu, observé, compris, ce que l’on faisait alors et à cette époque dans la musique baroque, ç’a été une tentation extraordinaire, j’ai tout de suite voulu commencer, et commencer comme on plonge dans l’océan, sans aucune retenue.
J’ai voulu rencontrer Chiara Banchini, que j’avais entendue, parmi d’autres violonistes baroques, et dont j’aimais le son et le tempérament. Sa latinité séduisante avait tout pour me plaire. Je l’ai rencontrée, et ensuite tout s’est enchaîné : après six mois d’études âpres, parce que c’était difficile de changer tant de choses, au niveau de la tenue par exemple, j’étais enfin convaincue d’avoir trouvé ma voie, et d’une manière foudroyante.

© Guy Vivien
Je suis allé la voir avec mon violon moderne, je lui ai joué du Bach, et je lui ai dit que je voulais étudier avec elle, mais étudier sérieusement, pas faire de la cosmétique de violon baroque, mais une vraie plongée. J’ai passé quelques examens — j’avais un peu d’habitude avec mes études de violon moderne — et je suis allé à Genève, où elle enseignait et j’y suis restée un an. Ensuite, elle a été nommée à Bâle, et je l’ai suivie. J’ai été admise à la Schola Cantorum de Bâle où j’ai étudié longuement avec elle. Je me suis ouverte à la musique ancienne. Fréquenter la classe de basse continue, celle de cornet ou celle de diminution, était un bonheur pour moi. Entendre les sacqueboutes jouer du Schein ou du Scheidt, la première fois, j’en étais renversée d’émotion ! Jouer dans la classe de hautbois baroque… Nous étions une minorité fervente, une grosse poignée de jeunes musiciens venus des quatre coins du monde, brûlée et dévorée par l’amour pour cette musique qui n’avait pas pignon sur rue.
Après ces quatre ou cinq ans d’études, je suis allée en Allemagne, où je suis restée dix ans. La Schola Cantorum Basiliensis était une porte ouverte sur le monde germanique : on y parlait plusieurs langues, mais l’allemand était la langue de l’école. Je suis allée à Cologne, où une autre figure du violon allait se révéler si importante pour moi : Reinhard Goebel. Après mes études à la Schola, c’était formidable pour moi d’être proche d’un tel musicien ; j’ai profité, au sens positif, d’une personnalité hors normes, et en même temps d’un monde du violon baroque qui n’avait rien à voir avec celui de Chiara Banchini et de la Schola. Ça me correspondait bien aussi: je m’appelle Schmitt, c’est le nom de mon père, c’est mon nom, qui s’accordait donc là avec ce monde, en accord avec une partie de mes origines mélangées et contrastées elles aussi, et ainsi c’était beau pour moi d’avoir des vues aussi contrastées sur le violon et la musique que celles offertes par Reinhard Goebel et Chiara Banchini.
A cette époque je jouais déjà sur la scène musicale. J’avais obtenu plusieurs prix internationaux, dès 1993, à Bruges, avant de sortir de la Schola. Et puis je travaillais : il fallait bien que l’argent vienne de quelque part ! Je finançais mes études moi-même. Quand j’habitais à Bâle, je venais souvent à Paris au Concert Spirituel, par exemple, gagner ma vie, il fallait payer mes écolages. Après les prix internationaux — Amsterdam Van Wassenaer et Prix Schmelzer à Melk, en Autriche — ma carrière se profilait, et j’ai eu la chance de pouvoir faire mon premier disque Uccellini pour le label allemand Christophorus et le soutien de la Hessische Rundfunk, puis de rencontrer Jean-Paul Combet et de faire huit disques de soliste chez Alpha. Le tout en 10 ans. Le premier disque Alpha — qui présentait des pièces pour violon et basse continue de Johann Sebastian Bach, avec Willem Jansen et Alain Gervreau, ces pièces d’attribution discutée, dont certaines sont bien avérées de Bach, et puis celle avec clavecin obligé qui est de Weiss en fait — a eu un vrai succès, et puis le disque consacré aux sonates d’Ignazio Albertini en a eu plus encore, il a reçu un Diapason d’Or. Je me suis concentrée alors de plus en plus sur ma carrière de soliste, même si j’ai continuée à être appelée à jouer avec tant de plaisir comme Konzertmeisterin dans certains ensembles de musique de chambre que j’aimais dans le monde germanique où j’avais déjà travaillé.
M.B. : Et puis il y a eu la formation du quatuor Baillot…
H.S. : Quand j’ai enregistré les Sonates et Partitas de Bach, je me projetais dans l’avenir, et j’avais déjà le désir d’aller plus loin dans le temps. Pendant ma formation sur le violon moderne, j’avais joué beaucoup de répertoire ; puis je m’étais concentrée pendant très longtemps, de longues années, uniquement sur le violon baroque.
J’avais donc envie, riche de ce chemin-là, d’aller chercher du côté de la musique classique et romantique. J’ai commencé à lire, à chercher, à essayer. J’ai enregistré ensuite un disque avec Rémy Cardinale (disque paru en 2011 chez Alpha) avec des sonates de Mozart et Beethoven. C’était il y a plus de trois ans, et ce moment-là, c’était clair dans ma tête : il fallait faire un quatuor. Est-ce que j’allais en être capable, tout en restant aussi la violoniste baroque que j’étais ? Est-ce que j’allais pouvoir ? Cependant, ce quatuor a réellement été mis sur pieds par la force de l’amitié : le second violon du quatuor, Xavier Julien-Laferrière, est un ami de très longue date, et ensemble, portés par cette profonde amitié et estime mutuelles, nous nous sommes dit qu’on allait le faire coûte que coûte. La part de l’amitié est énorme et tellement fondatrice ! Nous avons décidé de fonder ce quatuor après avoir cheminé chacun de son côté, sans se douter que nous nous retrouverions un jour comme partenaires de quatuor à cordes. Chacun avait cherché et trouvé son chemin. Xavier par exemple a fait beaucoup de musique contemporaine, il a joué avec Boulez, en plus de la musique baroque. Et c’est normal ! Quand on a 25, 30, 35 ans, on cherche encore ce qui va le mieux nous correspondre profondément, et ensuite arrive un moment où l’on est riche de son parcours, on va mieux partager encore ce qu’on a appris, avec les autres qui ont eux-mêmes un autre parcours. C’était le moment de se trouver comme partenaires.
M.B. : Parlons un peu de technique. Vous êtes passée d’abord du violon moderne au violon baroque, ce sont deux univers différents, en terme de tenue, mais aussi de justesse à cause du tempérament…
H.S. : Absolument ! On comprend tout l’éventail des possibilités de l’intonation en fonction des tempéraments. Il n’y a plus une justesse figée dans le marbre du tempérament égal. Ça ouvre beaucoup les oreilles, et le cœur aussi ! L’intonation est liée, profondément, à quelque chose d’intérieur, peut-être une harmonie intérieure. J’ai appris à comprendre qu’il n’y avait pas qu’une intonation parfaite, mais des intonations différentes et imparfaites bien que terriblement expressives dans lesquelles on cherche une résonance et un accord personnel avec les autres. Par exemple Uccellini ou Albertini sont enregistrés presque entièrement en tempérament mésotonique : il faut alors aller constamment dans le spectre de l’orgue ou du clavecin, c’est une chose merveilleuse, tout en sachant jouer comme un violoniste.
M.B. : Et quand vous abordez la période classique ?
H.S. : D’abord je change d’instrument. Certes, il y a toujours eu des gens qui jouaient tout sur les mêmes violons. Surtout dans des époques révolues où la musique n’était pas catégorisée comme elle l’est aujourd’hui. N’oublions pas que les violonistes de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe jouaient exclusivement la musique de leur temps et donc n’avaient probablement pas conscience qu’ils quittaient une époque, et donc un style particulier, pour plonger dans une autre. Leur répertoire, pour la plupart d’entre eux, oscillait au plus sur cinquante ans et l’on jouait tout avec le même style, même si bien sûr, la facture des instrument changeait, en parallèle des progrès de la science et du confort de la vie.
Les violons cependant passent dans le temps mieux que nous autres humains, et ils s’y bonifient, et il y a toujours eu des gens qui jouaient des violons anciens et les appréciaient — Bach par exemple avait une collection de Stainer —, et ces violons anciens que l’on gardait et que l’on se transmettait n’avaient pas toujours les montages dernier cri du moment. C’est ridicule de penser les choses seulement en terme de facture, alors qu’elle est pourtant capitale. Mais le style l’est encore davantage. Personnellement, je change de violon, aussi parce que je consacre mon violon baroque, à toute une époque (s’étendant de 1600 à peu près jusqu’en 1760) et l’autre violon — un instrument de 1764 — que je joue pour le quatuor, et aussi avec pianoforte, regarde résolument vers la musique romantique. Il n’a pas un chevalet moderne, ni baroque, mais classique, il a bien sûr un cordage en boyau, le réglage d’âme est différent… et je joue avec ce violon Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn et bien d’autres dont le style est pourtant si différent. Il y a aussi une manière autre de jouer, selon l’instrument et son réglage et j’aime bien que sur un instrument je retrouve un certain traitement physique du violon, tandis que sur l’autre, un autre, différent.
L’archet en revanche a davantage évolué. J’ai plein d’archets classiques et début romantique — quatre ou cinq. L’un sert plutôt pour Haydn, tandis qu’un autre ira mieux pour Beethoven… pour Schubert il faut un archet un peu plus gras, un peu plus onctueux. Chez Haydn, il y a encore tout l’héritage ancien : l’opus 33 est écrit en 1781, et le mouvement lent en sol mineur du quatuor no 5 que nous avons à notre programme est vraiment hérité de la musique baroque ; tant d’autres mouvements dans les quatuors de Haydn ont encore la verve, l’éloquence rapide de la musique baroque entre autres riches héritages. Dans les derniers quatuors de Mozart, et après , chez Boccherini, on voit plus loin, différemment, l’harmonie est moins importante, la mélodie est de plus en plus le point de mire. La mélodie prend ses aises, devient plus longue, plus ample plus prédominante, et moins dans la polarité constante du chant et de l’harmonie. Cette mélodie demande de plus en plus qu’on la traite d’une autre manière dans sa diction, avec un véritable soutien profond. Ainsi pour parvenir à faire tenir dans ses courbes naturelles une longue mélodie sur quinze mesures, il faut un souffle très puissant. En cela, on est aidé par par un archet plus lourd, plus gras, moins nerveux, moins sautant, qui offre une autre adhérence à la corde, qui fait sortir un son plus gras, un peu plus fort. Ce sont des archets capables de tenir un son du talon jusqu’à la pointe, à l’expansivité un peu plus corpulente… Avant, il fallait que les archets gardent les affects moins longtemps pour servir une musique intense et gracieuse comme du vif argent. Dans la musique romantique, l’on combine et l’on étaie les émotions selon une pâte sonore extrêmement riche et toute une palette de coloris subtils et en camaïeu.
Il ne faut pas que ce soit sclérosé, mais chercher dans la palette des couleurs qui vont capter l’attention. Ces archets subtils et différents aident à cela. Ça, c’est difficile. Par ailleurs, n se met à écrire plus aigu pour le violon, plus seulement une petite escalade ci et là, mais on développe systématiquement l’aigu. Le langage du violoncelle devient beaucoup plus virtuose. Après Boccherini, on n’écrira plus pour le violoncelle comme avant.

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Portrait du violoniste Pierre Baillot
Mine de plomb – 36,1 x 28 cm, Paris, collection Louis-Antoine Prat
M.B. : Quels sont vos projets, avec le quatuor et en tant que soliste ?
H.S. : Sans doute je continuerai à faire les choses lentement pour les faire le mieux que je le peux. On va jouer du Beethoven, du Mendelssohn avec le quatuor… En tant que soliste, je continue ce que j’ai commencé, le récital à violon seul dont répertoire m’intéresse tant, mais aussi le répertoire avec le pianoforte ou le clavecin et la basse continue. J’ai créé avec un danseur, Raphaël Cottin, depuis 2009 , un spectacle alliant violon et danse contemporaine. J’ai moi-même une passion pour la danse et je suis très attachée à ce langage. Je vais faire d’autres projets avec des danseurs.
J’ai aussi un spectacle avec une comédienne sur des textes de femmes que nous donnerons en 2013. Cette année, je me suis consacrée aussi à l’étude de pièces contemporaines, et avec grand plaisir, sur le violon baroque, et je vais m’y consacrer encore. Rien ne prend toute la place, je fais des choses nouvelles pour m’ouvrir le cœur et l’esprit.
M.B. : Le mot de la fin vous revient…
H.S. : Peut-être le mot de Baillot : “Pour se former le goût, l’artiste doué d’un esprit droit et d’une imagination ardente doit consacrer sa vie à la recherche de cette perfection idéale.” C’est-à-dire qu’il faut bien toute une vie pour bien jouer du violon et défendre le langage du violon.
Finalement nous, les musiciens, sommes des passeurs ; les violons restent, et nous passons. Pour moi, la polyvalence, c’est le parcours de toute une vie — et encore, quand je dis polyvalence, je reste sur mes cordes en boyau ! Oui, ça j’aurais envie de le dire comme mot de la fin : il faut bien toute une vie au service de son instrument et de la musique, ces choses-là s’apprennent, se comprennent lentement. Tchékhov fait dire à Nina dans La Mouette : “La longue patience pour devenir un artiste…”
M.B. : Hélène Schmitt, merci beaucoup pour cet entretien.
Propos recueillis par Loïc Chahine à Arques-la-Bataille le 22 août 2012.
Étiquettes : Loïc Chahine, violon Dernière modification: 9 juin 2020