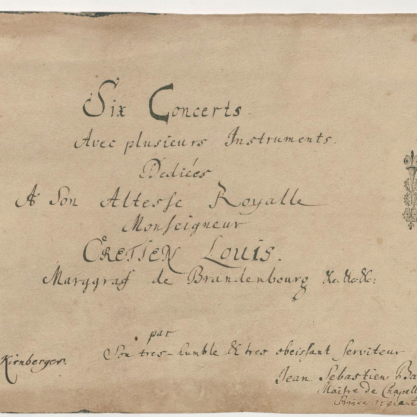Israël in Egypt, Oratorio HWV 54,
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Le Concert Lorrain, Nederlands Kamerkoor, dir. Roy Goodman
Cactus
Théâtre musical baroque
Laurent Carudel (conteur), Bruno Le Levreur, Sophie Pattey (chant), Françoise Defours, Marie-Noëlle Visse (flûtes à bec), Julie Dessaint (viole de gambe), Thibaut Roussel (théorbe), Stéphane Bazoge (lumières), Bernadète Bidaude (mise en espace)
Dimanche 21 septembre 2014 – Festival d’Ambronay
Au cœur de cette 35ème édition, foisonnante de conférences, visites, expositions (de matériel agricoles), et bien entendu de concerts, le contraste et la diversité règnent en maître. Seule la qualité demeure l’élément non négociable, et in facto non négocié.
En une après-midi, il nous fut donné d’assister à deux moments musicaux très différents. L’un eut lieu sous le chapiteau dressé dans la cour principale, et l’autre dans l’abbatiale. Le spectacle Cactus de Laurent Carudel, créé en 2012 et dédié aux jeunes publics (qui ne se définissent pas que par l’âge !), et l’oratorio Israël in Egypt de Georg Friedrich Haendel, par le Concert Lorrain et le Nederlands Kamerkoor. Mais revenons à notre fil rouge, le contraste. Contraste des lieux, contrastes des sujets et de leur envergure respective. Contraste du nombre de participants et de l’émotion transmise.
De Cactus1 restera l’impression d’un songe, d’une poésie en apparence naïve, réveillant en nous les souvenirs de l’école, de la cour avec ses grands marronniers, du directeur aux petites lunettes, des pensées qui nous emportaient entre deux phrases de grammaire. L’histoire du jeune Léo fait resurgir des questions que l’on s’est posées, enfant, sur le sens de la vie, et sur les actions « des grandes personnes » souvent incompréhensibles. Laurent Carudel et son équipe de musiciens nous renvoient à nous-mêmes, à notre passé, à nos rêves, à nos désillusions. La mère de Léo est morte. Mais on ne le dit pas. On ne le sait pas. On le sent, on le devine à demi-mots, et l’on reçoit tout ce qu’un tel bouleversement peut provoquer dans le cœur d’un enfant. Les « grands » spectateurs retrouvent leur histoire, les plus jeunes sont éveillés aux grandes questions de la vie. Si le sujet comporte indéniablement une part de tragique, c’est toujours avec une grande délicatesse et beaucoup d’humour que le conteur nous le soumet, effectuant sans cesse un aller-retour entre le jeu et l’interrogation, l’enthousiasme et le doute. La musique vient non pas interrompre le récit comme interlude, mais renforcer les images poétiques et la portée des mots. Ce que la langue ne peut pas définir clairement, la musique vient l’expliciter, l’amplifier, le concrétiser. Les deux se chevauchent parfois, s’interpellent ou se bousculent, s’interpellent du regard et se rejoignent dans l’expression des sentiments. Les frontières du réel s’estompent, une brise de légèreté infuse le cœur des spectateurs. Et quittant le chapiteau, l’on emporte cette odeur de jeunesse, ces couleurs chatoyantes, en contemplant les derniers mots semés par le conteur : « surtout n’oubliez pas, faites de beaux rêves… ».
A l’opposé de la touchante sobriété de Cactus, l’oratorio de Haendel fait impression par ses dimensions et l’effectif qu’il requiert ; œuvre monumentale (environ trois heures de musique), animée par une soixantaine de musiciens. C’est à la fois une force et un écueil, que Roy Goodman n’a pas vraiment su éviter. Contrairement à notre collègue enchanté par le même concert donné à l’Arsenal de Metz, nous ne fûmes pas convaincus par la dynamique donnée à l’œuvre (principalement imputable aux tempi), en dépit d’un engagement sincère des musiciens. Si l’ensemble sonna avec générosité sous les voûtes de l’abbatiale, ce ne fut pas sans une certaine lourdeur, une tendance mahlérienne à la lenteur et à ce qui est pesant. Le brio des solistes (notamment la soprano Julia Doyle et le ténor James Ghilchrist), la verve charnue des instrumentistes (pensons à Chouchane Siranossian, premier violon qui prit le Concert Lorrain à bras le corps dans les intentions musicales), l’éclat et la puissance du Nederlands Kamerkoor, la complicité du chef avec ses musiciens… autant d’atouts qui ne suffirent pas à tromper un ennui insidieux. Ennui récurrent dans les récitatifs, permettant habituellement une avancée narrative en déployant peu de moyens et rendus ici avec beaucoup d’emphase et de manière très mesurée. Ennui également dans les fugues, en dépit d’une pâte sonore pleine et moelleuse, mais trop statique.
Est-il concevable que le père d’airs aussi sensuels que le « Dove sei » de Rodelinda ait conçu cet oratorio avec une pompe un peu ankylosante ? Certains diront qu’il ne s’agit pas d’opéra, que l’œuvre est destinée à l’église et non au théâtre et qu’elle implique une certaine révérence. N’oublions pas cependant qu’au XVIIème siècle, la limite entre sacré et profane n’était pas aussi nette que le veut la classification moderne. N’oublions pas non plus que l’oratorio vint pour un temps remplacer les représentations opératiques, interdites durant le Carême. Une sorte de substitut qui devait répondre au besoin de se divertir et de se confronter aux mouvements des passions humaines.
La musique est un geste, figé sur du papier, auquel il convient de redonner à chaque fois l’élan de sa conception, pour qu’il puisse lui-même renouveler le vivant.
Isaure Lavergne
1 : Le spectacle Castus fera l’objet d’un compte-rendu plus détaillé ainsi que d’une interview.
Étiquettes : Ambronay, festival, Haendel, Isaure Lavergne Dernière modification: 8 juin 2021